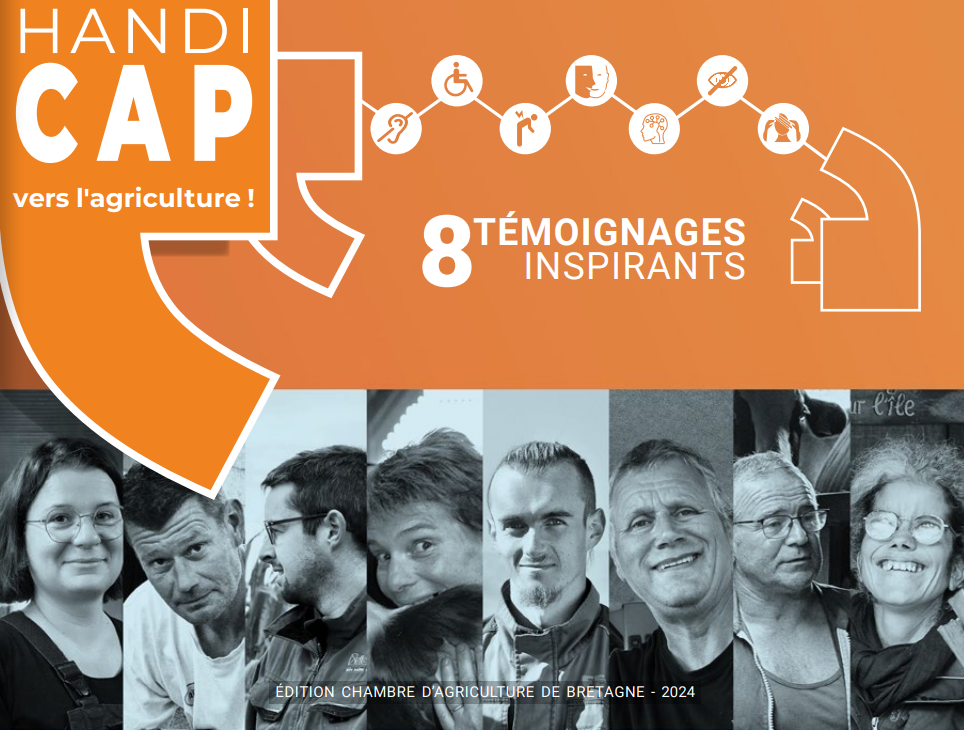Les Journées Nationales de l’Agriculture, moment d’échanges privilégiés entre les professionnels et le grand public, se dérouleront les 7, 8 et 9 juin 2024. La manifestation, placée sous le haut patronage du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et coorganisée par Make.org Foundation et #agridemain, entend cette année sensibiliser à l’éducation à l’alimentation.
Durant 3 jours, sur l’ensemble du territoire, exploitations agricoles, sites d’expérimentations, entreprises agroalimentaires et d’agrofournitures… ouvriront leurs portes aux curieux. Des centaines de rendez-vous accueilleront le public pour des visites, libres ou commentées, des ateliers pédagogiques, des dégustations ou encore des tables rondes sur les enjeux du secteur. Cet événement, festif et convivial, est l’occasion pour les acteurs des filières agroalimentaires d’exposer leur savoir-faire et la réalité de leurs métiers. Une opportunité de dialogue qui fait écho aux préoccupations du monde agricole. Dans un contexte où les producteurs demandent plus de reconnaissance de leur travail, les JNAgri, durant lesquelles les Français se déplacent dans les fermes, sont un complément essentiel au Salon international de l’agriculture. Ces journées visent aussi à éclairer les visiteurs sur leur rapport aux questions environnementales et de santé publique.
L’éducation à l’alimentation au cœur des JNAgri 2024
Les participants auront l’occasion d’approfondir leurs connaissances des produits et de leurs filières, favorisant ainsi la promotion du travail des professionnels et de l’agriculture française. Cette proximité encouragera probablement les consommateurs à privilégier les circuits courts et les produits français.
Cette année, les JNAgri se penchent sur la thématique de l’éducation à l’alimentation. Une démarche répondant notamment aux problématiques sociétales majeures de la prise en compte de l’environnement et de la santé des consommateurs. Les professionnels partageront ainsi des pistes pour adopter des comportements alimentaires sains et qualitatifs.
Une consultation citoyenne autour de l’alimentation
Souhaitant initier une acton impactante auprès des plus jeunes, en complément des animations qui leur seront proposées pendant les JNAgri, Make.org Foundation, #agridemain et Open Agrifood ont lancé, le 25 février au Salon international de l’agriculture, une grande consultation citoyenne nationale. Avec le parrainage du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le coup d’envoi de l’opération participative s’est déroulé en présence de Guillaume Gomez, ambassadeur de la gastronomie française, Thierry Marx, chef étoilé et Erik Orsenna, écrivain et académicien.
Jusqu’au 25 avril, les Françaises et Français sont donc invités à répondre à la question : « Comment sensibiliser et éduquer nos enfants à mieux manger ? » et à voter en se connectant sur educalimentation.make.org. Les résultats de la consultation seront dévoilés le 7 juin lors du lancement officiel des JNAgri, aux Arènes de Lutèce à Paris.
Les JNAgri, un rendez-vous incontournable
Nicolas Chabanne, fondateur de C’est qui le patron ?!, marque qui permet aux consommateurs de définir les cahiers des charges de leurs produits et de soutenir les producteurs au juste prix, portera la parole des consommateurs dans cette 4 e édition.
Depuis sa création, les JNAgri, appréciées tant par le grand public que par les professionnels, rencontrent un succès croissant. En 2023, 1330 événements (131 de plus qu’en 2022) ont été organisés sur plus de 900 lieux distincts de l’ensemble du territoire national.
Inscription des événements en ligne
Les professionnels souhaitant participer peuvent inscrire leurs événements sur le site journeesagriculture.fr. Actualités, programme, boîte à outils, visuels et kit de communication y sont également accessibles.